

- Culture numérique
- Sensibilisation
- Exploration
- Expérimentation
- Atelier
Le

Le Shadok, lieu dédié à l’initiation et à la sensibilisation au numérique responsable, se distingue par une programmation diversifiée.
Son objectif est double : faciliter l’appropriation des outils numériques par des formations complètes alliant théorie et pratique, tout en créant un espace privilégié pour une réflexion critique sur nos usages numériques quotidiens et bien plus.
En qualité de centre de ressources pour le territoire, le Shadok est accessible à l’ensemble des habitants et habitantes, offrant ainsi une opportunité inclusive d’exploration et de compréhension approfondie des enjeux liés au numérique.
c'est quoi ?
c'est quoi ?

Agenda
Activité

La CyberGrange
Con
Sor
Tium
Le Shadok est dirigé par un consortium de cinq associations constituant le noyau de cet « écosystème d’acteurs du territoire »

Longevity Music School
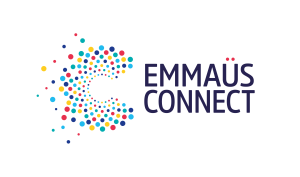
Emmaüs Connect

La Ligue de l’Enseignement

Random Bazar
Con
Sor
Tium
Le Shadok est dirigé par un consortium de cinq associations constituant le noyau de cet « écosystème d’acteurs du territoire »
La Cybergrange

Longevity Music Festival

Emmaüs Connect
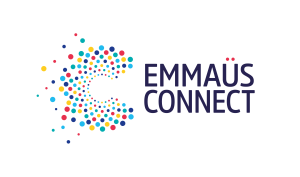
La ligue de l'enseignement

Random Bazar

Les partenaires
du Shadok
Le Shadok, lieu dédié à l’initiation et à la sensibilisation au numérique responsable, se distingue par une programmation diversifiée.
Son objectif est double : faciliter l’appropriation des outils numériques par des formations complètes alliant théorie et pratique, tout en créant un espace privilégié pour une

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Résidents
Le Shadok, lieu dédié à l’initiation et à la sensibilisation au numérique responsable, se distingue par une programmation diversifiée.
Fondé en 2009, Ernestine est un studio de développement de jeux vidéo indépendant.
Notre expérience, forgée dans la création de serious games, nous pousse à questionner le
medium interactif, ses cultures et ses modèles économiques sans perdre de vue sa qualité de
jeu et sa narration.
Pour résumer, nous travaillons pour que vous vous amusiez, et nous aimons ça !

Random Bazar, c’est une petite structure très motivée organisant divers événements et animations autour du jeu vidéo :
● jeux vidéo alternatifs
● conf’ dont vous êtes les héro/ïne/s
● ateliers analyse & création Éduco’jeux
● formations destinées aux professionnels
Random Bazar, c’est un cabinet de curiosités pop cherchant à promouvoir le jeu vidéo comme un espace de socialisation et un art à part entière.

La mission du Hub Est est de fédérer et d’accompagner les acteurs opérationnels et publics du Grand Est dans leurs actions pour l’inclusion numérique, en leur proposant des outils utiles à leur activité et en aidant à la recherche de financement. Le Hub Est s’adresse aux collectivités, acteurs de terrain, opérateurs qui veulent agir sur le numérique inclusif et lutter contre l’illectronisme.
![]()
Reconnect est une association à but non lucratif dont la mission est de faciliter la progression des parcours d’insertion sociale tout en simplifiant l’accompagnement des professionnels.
Nous pensons que l’action sociale et le numérique gagnent à travailler davantage ensemble pour permettre l’inclusion sociale des populations vulnérables.
Depuis 2015, nous nous engageons auprès des bénéficiaires et des professionnels de l’action
sociale, en créant des solutions pour répondre à leurs besoins.

East Game
Depuis 2016, East Games accompagne les professionnel·les du jeu vidéo dans la région Grand
Est. L’association aspire à structurer la filière de l’industrie en coopération avec les institutions
de la Région, les municipalités ainsi que les autres associations régionales et nationales.

Ernestine
Fondé en 2009, Ernestine est un studio de développement de jeux vidéo indépendant.
Notre expérience, forgée dans la création de serious games, nous pousse à questionner le
medium interactif, ses cultures et ses modèles économiques sans perdre de vue sa qualité de
jeu et sa narration.
Pour résumer, nous travaillons pour que vous vous amusiez, et nous aimons ça !

Random Bazar
Random Bazar, c’est une petite structure très motivée organisant divers événements et animations autour du jeu vidéo :
● jeux vidéo alternatifs
● conf’ dont vous êtes les héro/ïne/s
● ateliers analyse & création Éduco’jeux
● formations destinées aux médiathécaires et professionnels de l’éducation…
Random Bazar, c’est un cabinet de curiosités pop cherchant à promouvoir le jeu vidéo comme un espace de socialisation et un art à part entière.

Hub Est
La mission du Hub Est est de fédérer et d’accompagner les acteurs opérationnels et publics du Grand Est dans leurs actions pour l’inclusion numérique, en leur proposant des outils utiles à leur activité et en aidant à la recherche de financement. Le Hub Est s’adresse aux collectivités, acteurs de terrain, opérateurs qui veulent agir sur le numérique inclusif et lutter contre l’illectronisme.
![]()
Longevity Music School
Depuis 2018, à Strasbourg, Longevity Music School est une école de musique et un centre de formation dédié à la production musicale électronique sous toutes ses formes. L’école et sa pédagogie sont certifiées par Ableton depuis 2020.

Reconnect
Reconnect est une association à but non lucratif dont la mission est de faciliter la progression des parcours d’insertion sociale tout en simplifiant l’accompagnement des professionnels.
Nous pensons que l’action sociale et le numérique gagnent à travailler davantage ensemble pour permettre l’inclusion sociale des populations vulnérables.
Depuis 2015, nous nous engageons auprès des bénéficiaires et des professionnels de l’action
sociale, en créant des solutions pour répondre à leurs besoins.







